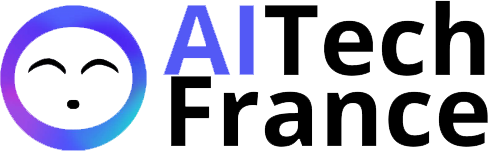Telle une armée invisible déployant ses bataillons de pixels à travers l’espace et le temps, la télémédecine s’impose désormais dans le paysage sanitaire français. En effet, cette pratique médicale à distance recourt aux nouvelles technologies pour favoriser l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Elle a connu son apogée en 2020, lors de l’épidémie de Covid-19. Toutefois, après cette tempête sanitaire, en quoi cette pratique peut-elle continuer de répondre aux défis de notre système de santé ?
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite « loi HPST ») définit et réglemente pour la première fois la télémédecine en France. En 2018, cette modalité de soin entre dans le droit commun de l’Assurance maladie, établissant ainsi les fondations d’une nouvelle ère médicale.

Quels sont les actes pratiqués en télémédecine ?
Le décret du 19 octobre 2010, pris en application de la loi HPST, définit cinq actes médicaux réalisables en télémédecine, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
La téléconsultation
Il s’agit d’une consultation à distance, entre un médecin et un patient (seul ou assisté d’un professionnel de santé). Tout médecin libéral ou salarié d’un établissement de santé peut effectuer une téléconsultation, qu’il facture au tarif d’une consultation en présentiel. Toutes les situations médicales peuvent donner lieu à une téléconsultation, mais le recours à cette pratique relève de la seule décision du médecin.
La téléexpertise
Elle consiste en un échange entre au moins deux médecins qui arrêtent ensemble, avec le consentement du patient, un diagnostic ou une stratégie thérapeutique. Ils s’appuient sur des données biologiques, radiologiques ou cliniques. La téléexpertise permet d’obtenir rapidement l’avis d’un spécialiste, réduisant ainsi les délais de prise en charge et de suivi.
Autres types d’actes de télémédecine
- La télésurveillance médicale : un médecin interprète à distance les données cliniques ou biologiques recueillies par le patient ou un professionnel de santé.
- La téléassistance : un médecin assiste à distance l’un de ses confrères pendant un acte médical ou chirurgical.
- La régulation : les médecins des centres 15 (SAMU) établissent par téléphone un premier diagnostic pour déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la situation.
La télémédecine, une réponse aux défis du système de santé ?
La télémédecine offre une solution possible aux principaux problèmes de santé publique actuels. Elle ne remplace pas les pratiques médicales traditionnelles mais facilite l’accès aux soins de proximité, pallie le manque de personnel médical et renforce les missions des établissements isolés.
Une étude publiée en décembre 2022 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) révèle des chiffres impressionnants. Les médecins généralistes libéraux ont réalisé 800 000 téléconsultations en 2019, 13,5 millions en 2020 et 9,4 millions en 2021. Les généralistes salariés en centres de santé en ont effectué 600 000 en 2020 puis 1,1 million en 2021.
Maîtriser les dépenses de santé grâce à la télémédecine
La télémédecine vise aussi à réduire les coûts grâce à une restructuration des soins et une mise en commun des compétences médicales. En abolissant les distances, la téléconsultation simplifie l’accès à un médecin pour les personnes à mobilité réduite. Elle diminue également les coûts liés aux transferts inutiles de patients et aux passages aux urgences.
La télésurveillance aide à maintenir plus longtemps à domicile les personnes en situation de dépendance. La téléexpertise, en associant des avis de spécialistes, accélère la prise en charge des patients et améliore sa qualité. Elle présente deux avantages majeurs : un gain de temps et le désengorgement des cabinets médicaux.
Les patients souffrant de maladies chroniques nécessitant un suivi continu bénéficient également de la télémédecine. Cette approche permet de limiter les investissements humains et financiers générés par ces pathologies, dont le nombre augmente avec le vieillissement de la population.
Lutter contre les déserts médicaux avec la télémédecine
La télémédecine combat efficacement la pénurie de praticiens dans les zones rurales et urbaines. Selon un communiqué de la Drees paru en novembre 2023, « l’accessibilité aux médecins généralistes continue de se dégrader en 2022 ». Cette dégradation ralentit néanmoins (-0,8% contre -1,8% par an en moyenne entre 2015 et 2021), notamment grâce à l’augmentation de l’offre de soins en centre de santé.
Un rapport d’information sénatorial de mars 2022 souligne que les inégalités territoriales d’accès aux soins s’accentuent et que 30,2% des Français résident dans un désert médical.
La télémédecine encourage également l’activité des professionnels de santé en réseau. Cela contribue à renforcer l’attractivité de la médecine libérale, actuellement en déclin. Une étude de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) indique qu’en 2022, 62% des jeunes praticiens optent pour le salariat, contre seulement 12% pour l’exercice exclusivement libéral.
Une pratique adoptée par les Français
Les usagers semblent prêts à adopter cette pratique. Une enquête sur « les Français et le numérique en santé » publiée en février 2024 par le ministère du travail, de la santé et des solidarités met en lumière la perception de la télémédecine en 2023 :
- 90% des Français utilisent désormais les outils ou services numériques de santé (prise de rendez-vous, récupération de documents, services en ligne, téléconsultation, objets connectés…)
- 74% estiment que ces outils améliorent la coordination du parcours médical
- 72% considèrent qu’ils simplifient les démarches administratives
Néanmoins, des inquiétudes persistent concernant la déshumanisation des soins, les inégalités d’accès et la sécurité des données. Ainsi, 78% des Français craignent que leurs données de santé fassent l’objet d’usages commerciaux.
Une montée en puissance progressive
Une courte phase expérimentale
En 2012, le gouvernement lance le Pacte territoire santé 2012-2015 pour faire reculer les déserts médicaux. Le développement de la télémédecine figure parmi ses 12 engagements. Un second plan lui succède jusqu’en 2017, favorisant l’accès à la télémédecine pour les patients chroniques et les soins urgents.
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 instaure l’expérimentation de la télémédecine pour quatre ans. Le programme Etapes (Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé) soutient financièrement le déploiement de projets de télésanté. Ces expérimentations, d’abord limitées à neuf régions, s’étendent à tout le territoire en 2017. La LFSS pour 2018 reconduit le dispositif pour quatre ans, ciblant la télésurveillance des affections de longue durée (ALD).
Une reconnaissance juridique
La LFSS pour 2018 intègre la téléconsultation dans le droit commun de l’Assurance maladie. Un accord signé en juin 2018 entre les syndicats médicaux et la CNAM établit un cadre légal précisant les principes et modalités de la télémédecine.
Depuis le 15 septembre 2018, les téléconsultations sont accessibles à tous les patients et remboursées comme des consultations classiques, sous certaines conditions :
- Réalisation par vidéotransmission via une plateforme sécurisée
- Inscription dans le parcours de soins coordonné (orientation par le médecin traitant, sauf exceptions)
- Proximité géographique entre le médecin et le patient
- Alternance entre consultations présentielles et téléconsultations
- Rédaction d’un compte rendu dans le dossier du patient
Le plan quinquennal contre les déserts médicaux de 2017 prévoit d’équiper tous les EHPAD et zones sous-denses en matériel de téléconsultation d’ici 2020, pour éviter des hospitalisations inutiles et améliorer le suivi des patients.
La téléexpertise, remboursée depuis février 2019, s’est progressivement étendue à tous les patients en 2022. La télésurveillance bénéficie d’une prise en charge depuis juillet 2023 pour certaines pathologies.
La régulation croissante des pratiques
En juillet 2022, le groupe Ramsay lance une offre de téléconsultations par abonnement (11,90€ mensuel). Ces consultations, non remboursées par l’Assurance maladie, peuvent néanmoins donner lieu à des prescriptions prises en charge. Une mission parlementaire critique cette initiative qui:
- Contourne le parcours de soins coordonné
- Risque d’accentuer les inégalités d’accès
- Permet des pratiques lucratives déterritorialisées
Selon ce rapport, cette offre illustre « une conception consumériste et marchande de la santé » et s’est d’ailleurs soldée par un échec commercial. La mission appelle à réguler les téléconsultations face au « risque de financiarisation ».
En mai 2023, le gouvernement présente sa Feuille de route du numérique en santé 2023-2027 avec quatre axes:
- Développer la prévention et responsabiliser les patients
- Libérer du temps médical grâce au numérique
- Améliorer l’accès aux soins, notamment via la télésanté dans les zones sous-denses
- Créer un environnement favorable à l’innovation
La LFSS pour 2023 encadre les sociétés de téléconsultation en créant un agrément permettant le remboursement des actes réalisés par leurs médecins salariés depuis janvier 2024. La LFSS pour 2024 limite la prescription d’arrêts de travail en téléconsultation à trois jours maximum depuis février 2024.
Une pratique plébiscitée pendant l’épidémie de Covid-19 mais après ?
L’explosion durant la crise sanitaire
Avant la pandémie, la CNAM recensait environ 40 000 téléconsultations remboursées mensuellement. Dès l’instauration du confinement en mars 2020, la pratique connaît un essor spectaculaire.
L’état d’urgence sanitaire assouplit considérablement les règles:
- Accès sans orientation préalable du médecin traitant
- Possibilité de consulter un médecin inconnu
- Autorisation des consultations téléphoniques pour certains patients vulnérables
- Prise en charge à 100% par l’Assurance maladie
De 486 369 lors de la dernière semaine de mars 2020, le nombre hebdomadaire de téléconsultations atteint 1 million en avril, avant de redescendre à environ 650 000 fin mai. Les médecins généralistes réalisent 80% de ces actes, suivis par les psychiatres, pédiatres, gynécologues et autres spécialistes.
La pandémie modifie le profil des patients utilisant la téléconsultation. Les moins de 30 ans la sollicitent moins qu’avant (19% contre 32%), tandis que les plus de 70 ans y recourent davantage (20% contre 8%). Toujours surreprésentée en Île-de-France, la pratique progresse néanmoins dans toutes les régions.
La stabilisation post-crise
Dès le déconfinement, le volume de téléconsultations diminue tout en restant élevé. En juin 2020, l’Assurance maladie enregistre une baisse progressive: 521 000 la première semaine, puis 506 000, 427 000 et enfin 396 000.
Dans son rapport de juillet 2020, la CNAM préconise que la téléconsultation devienne « une modalité d’accès aux soins choisie et non subie », adaptée à chaque situation. Elle formule trois recommandations:
- Prolonger la prise en charge à 100% pendant au moins un an
- Assouplir l’obligation de connaissance préalable du patient
- Maintenir transitoirement les actes dérogatoires de télésoin
Ces propositions intègrent les préconisations du Ségur de la santé pour pérenniser l’essor de la télémédecine, désormais ancrée dans les pratiques malgré un recul post-pandémique.